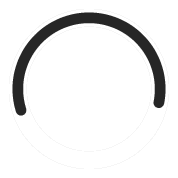Essai sur l'origine des connaissances humaines
1746
p. 149
« La précision du style fut connue beaucoup plus tôt chez les peuples du nord. Par un effet de leur tempérament froid et flegmatique, ils abandonnèrent plus facilement tout ce qui se ressentait du langage d'action. Ailleurs, les influences de cette manière de communiquer ses pensées se conservèrent longtemps. Aujourd'hui même, dans les parties méridionales de l'Asie, le pléonasme est regardé comme une élégance du discours. § 67. Le style, dans son origine, a été poétique... » (p. 149).
Cited in De la grammatologie p.370
Essai sur l'origine des langues
1817
« Cela dût être. On ne commença pas par raisonner, mais par sentir. On prétend que les hommes inventèrent la parole pour exprimer leurs besoins ; cette opinion me paraît insoutenable. L'effet naturel des premiers besoins fut d'écarter les hommes et non de les rapprocher. Il le fallait ainsi pour que l'espèce vînt à s'étendre, et que la terre se peuplât promptement ; sans quoi le genre humain se fût entassé dans un coin du monde, et tout le reste fût demeuré désert. »
Cited in De la grammatologie p.371
Encyclopédie
1751
MÉTAPHORE, S.F. (gram.) « C'est, dit M. du Marsais, une figure par laquelle on transporte, pour ainsi dire, la signification propre d'un nom (j'aimerais mieux dire d'un mot) à une autre signification qui ne lui convient qu'en vertu d'une comparaison qui est dans l'esprit. Un mot pris dans un sens métaphorique perd sa signification propre, et en prend une nouvelle qui ne se présente à l'esprit que par la comparaison que l'on fait entre le sens propre de ce mot, et ce qu'on lui compare : par exemple, quand on dit que le mensonge se pare souvent des couleurs de la vérité... »
Cited in De la grammatologie p.372
Encyclopédie
1751
Et après de larges citations de Marsais : « J'ai quelquefois ouï reprocher à M. de Marsais d'être un peu prolixe ; et j'avoue qu'il était possible, par exemple, de donner moins d'exemples de la métaphore, et de les développer avec moins d'étendue : mais qui est-ce qui ne porte point envie à une si heureuse prolixité ? L'auteur d'un dictionnaire de langue ne peut pas lire cet article de la métaphore sans être frappé de l'exactitude étonnante de notre grammairien, à distinguer le sens propre du sens figuré, et à assigner dans l'un le fondement de l'autre... »
Cited in De la grammatologie p.372
Essai sur l'origine des langues
1817
« Or, je sens bien qu'ici le lecteur m'arrête, et me demande comment une expression peut être figurée avant d'avoir un sens propre, puisque ce n'est que dans la translation du sens que consiste la figure. Je conviens de cela ; mais pour m'entendre il faut substituer l'idée que la passion nous présente au mot que nous transposons ; car on ne transpose les mots que parce qu'on transpose aussi les idées : autrement le langage figuré ne signifierait rien. »
Cited in De la grammatologie p.373
Émile ou de l'éducation
1762
que le manuscrit autographe avait remplacé par celui-ci : « Je dis qu'il est impossible que nos sens nous trompent car il est toujours vrai que nous sentons ce que nous sentons. »
Cited in De la grammatologie p.373
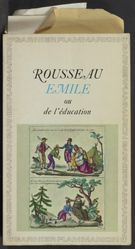
Émile ou de l'éducation
1966
Sur ce point, la doctrine de Rousseau est très cartésienne. Elle s'interprète elle-même comme une justification de la nature. Les sens, qui sont naturels, ne nous trompent jamais. C'est notre jugement qui, au contraire, nous égare et trompe la nature. « Jamais la nature ne nous trompe ; c'est toujours nous qui nous trompons. » Passage de l'Emile (p. 237)
Cited in De la grammatologie p.373
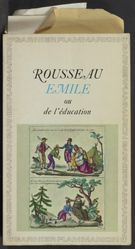
Émile ou de l'éducation
1966
Les Epicuriens sont loués de l'avoir reconnu mais critiqués d'avoir prétendu que « les jugements que nous faisions sur nos sensations n'étaient jamais faux ». « Nous sentons nos sensations, mais nous ne sentons pas nos jugements. »
Cited in De la grammatologie p.373
Essai sur l'origine des langues
1817
« Un homme sauvage en rencontrant d'autres se sera d'abord effrayé. Sa frayeur lui aura fait voir ces hommes plus grands et plus forts que lui-même ; il leur aura donné le nom de géants. Après beaucoup d'expériences, il aura reconnu que ces prétendus géants n'étant ni plus grands ni plus forts que lui, leur stature ne convenait point à l'idée qu'il avait d'abord attachée au mot de géant. Il inventera donc un autre nom commun à eux et à lui, tel par exemple que le nom d'homme, et laissera celui de géant à l'objet faux qui l'avait frappé durant son illusion. Voilà comment le mot figuré naît avant le mot propre, lorsque la passion nous fascine les yeux, et que la première idée qu'elle nous offre n'est pas celle de la vérité. Ce que j'ai dit des mots et des noms est sans difficulté pour les tours de phrases. L'image illusoire offerte par la passion se montrant la première, le langage qui lui répondait fut aussi le premier inventé ; il devint ensuite métaphorique, quand l'esprit éclairé, reconnaissant sa première erreur, n'en employa les expressions que dans les mêmes passions qui l'avaient produite. »
Cited in De la grammatologie p.374
Essai sur l'origine des langues
1817
« Un homme sauvage en rencontrant d'autres se sera d'abord effrayé. »
Cited in De la grammatologie p.376
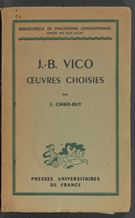
Scienza Nuova in Oeuvres choisies de Vico
pp. 94-95
On rappellera ici encore un texte de Vico : « Les caractères poétiques qui constituent l'essence même des fables, dérivent par un lien nécessaire de la nature même des premiers hommes, incapables d'abstraire les formes et les propriétés des sujets ; ils durent être une façon de penser commune à tous les individus de peuples entiers, à l'époque où ces peuples étaient engagés dans la plus grande barbarie. Parmi ces caractères, nous pouvons mentionner une disposition à agrandir démesurément, en toutes circonstances, les images des objets particuliers. C'est ce que remarque Aristote : l'esprit humain, que sa nature porte à l'infini, se voit gêné, étouffé par la vigueur des sens ; un seul moyen lui est laissé de montrer tout ce qu'il doit à sa nature quasi divine : se servir de l'imagination pour agrandir les images particulières. C'est pourquoi, sans doute, chez les poètes grecs, — et aussi chez les poètes latins —, les images qui représentent les dieux et les héros sont toujours plus grandes que celles qui représentent les hommes. Et quand revinrent les temps barbares et que recommença le cours de l'histoire, les fresques et les tableaux où sont peints le Père Eternel, Jésus-Christ et la Vierge Marie nous présentent des Etres divins démesurément agrandis. » (Scienza nuova, 3, II, p. 18, trad. Chaix-Ruy.)
Cited in De la grammatologie p.376
Essai sur l'origine des connaissances humaines
1746
pp. 111-112
Il ne suffit pas à « un philosophe de dire qu'une chose a été faite par des voies extraordinaires ». Il est « de son devoir d'expliquer comment elle aurait pu se faire par des moyens naturels ».
Cited in De la grammatologie p.377
Essai sur l'origine des connaissances humaines
1746
pp. 111-112
C'est alors l'hypothèse des deux enfants égarés dans le désert après le déluge, « sans qu'ils connussent l'usage d'aucun signs ».
Cited in De la grammatologie p.377
Essai sur l'origine des connaissances humaines
1746
p. 113
« Ainsi, par le seul instinct, ces hommes se demandaient et se prêtaient secours. Je dis par le seul instinct, car la réflexion n'y pouvait encore avoir part. L'un ne disait pas : il faut m'agiter de telle manière pour lui faire connaître ce qui m'est nécessaire, et pour l'engager à me secourir ; ni l'autre : je vois à ses mouvements qu'il veut telle chose, je vais lui en donner la jouissance ; mais tous deux agissaient en conséquence du besoin qui les pressait davantage... Celui, par exemple, qui voyait un lieu où il avait été effrayé, imitait les cris et les mouvements qui étaient les signes de la frayeur, pour avertir l'autre de ne pas s'exposer au danger qu'il avait couru. »
Cited in De la grammatologie p.377
The Divine legation of Moses
1744
p. 48
Cette démarche est aussi celle de Warburton dans les remarquables paragraphes qu'il consacre aux Origine et progrès du langage (T. I. p. 48 sq.). Ainsi : « A juger seulement par la nature des choses, et indépendamment de la révélation, qui est un guide plus sûr, l'on serait porté à admettre l'opinion de Diodore de Sicile et de Vitruve, que les premiers hommes ont vécu pendant un temps dans les cavernes et les forêts, à la manière des bêtes, n'articulant que des sons confus et indéterminés, jusqu'à ce que, s'étant associés pour se secourir mutuellement, ils soient arrivés par degrés à en former de distincts, par le moyen de signes ou de marques arbitraires convenues entre eux, afin que celui qui parlait, pût exprimer les idées qu'il avait besoin de communiquer aux autres. C'est ce qui a donné lieu aux différentes langues ; car tout le monde convient que le langage n'est point inné. »
Cited in De la grammatologie p.377
The Divine legation of Moses
1744
Et pourtant, « rien de plus évident par l'Ecriture sainte que le langage a une origine différente. Elle nous apprend que Dieu enseigna la Religion au premier homme ; ce qui ne nous permet pas de douter qu'il ne lui ait enseigné en même temps à parler. »
Cited in De la grammatologie p.377