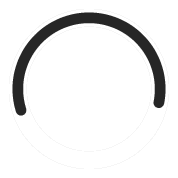Essai sur l'origine des langues
1817
« Comme les premiers motifs qui firent parler l'homme furent des passions, ses premières expressions furent des tropes. Le langage figuré fut le premier à naître, le sens propre fut trouvé le dernier. On n'appela les choses de leur vrai nom que quand on les vit sous leur véritable forme. D'abord on ne parla qu'en poésie ; on ne s'avisa de raisonner que longtemps après. »
Cited in De la grammatologie p.366
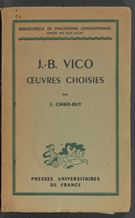
Scienza Nuova in Oeuvres choisies de Vico
p. 174
Vico dit avoir compris l'origine des langues au moment où après bien des difficultés, il lui est apparu que les premières nations « avaient été des nations de poètes ; dans ces mêmes principes, nous reconnûmes alors la véritable origine des langues » (Scienza nuova, 1, p. 174).
Cited in De la grammatologie p.367
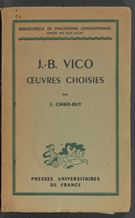
Scienza Nuova in Oeuvres choisies de Vico
pp. 76-77
On comparera : « Trois espèces de langues furent successivement parlées : a) la première, au temps de la vie familiale : les hommes, groupés seulement en famille, étaient depuis peu revenus à l'humanité. Cette première langue fut une langue muette, au moyen de signes et par le choix de certaines positions du corps pouvant présenter des rapports avec les idées qu'elles veulent signifier ; b) la seconde, composée d'emblèmes héroïques : ce fut une langue basée sur des ressemblances, langue symbolique formée de comparaisons, d'images très vives, de métaphores, de descriptions naturelles ; ces images sont le corps principal de cette langue héroïque, qui fut parlée alors que régnaient les héros ; c) la troisième fut la langue humaine composée de vocables établis par les peuples, de mots dont ils peuvent fixer le sens à leur gré. » (3, 1, p. 32).
Cited in De la grammatologie p.367
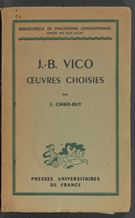
Scienza Nuova in Oeuvres choisies de Vico
p. 78
Ailleurs : « Cette première langue ne fut point fondée sur la nature même des choses ; ce fut une langue toute en images, en images divines pour la plupart, qui transformait en êtres animés les choses inanimées » (3, 1, p. 163).
Cited in De la grammatologie p.367
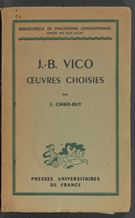
Scienza Nuova in Oeuvres choisies de Vico
pp. 82-83
« Or si nous cherchons le principe d'une telle origine des langues et des lettres, nous le rencontrons dans ce fait : les premiers peuples des nations païennes, par une nécessité qui tenait à leur nature, furent des poètes ; ils s'exprimèrent au moyen de caractères poétiques. Cette découverte est la clé maîtresse de notre Science nouvelle ; elle nous a coûté de longues recherches qui ont rempli toute notre vie de lettré. » (3, Idea del l'Opéra, I, pp. 28-29).
Cited in De la grammatologie p.367
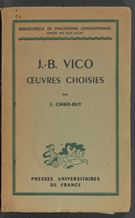
Scienza Nuova in Oeuvres choisies de Vico
p. 77
« Les hommes se libèrent de leurs grandes passions en chantant... ils ne durent de devenir capables de former, en chantant, les premières langues qu'à l'aiguillon de très violentes passions. » (3, 1, p. 95, trad. Chaix-Ruy).
Cited in De la grammatologie p.367
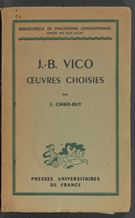
Scienza Nuova in Oeuvres choisies de Vico
p. 77
Pour Vico, comme pour Rousseau, les progrès de la langue suivent les progrès de l'articulation. La langue déchoit ainsi, elle s'humanise en perdant sa poésie et son caractère divin : « La langue des dieux fut une langue muette, à peine articulée ; la langue héroïque fut, en partie articulée, en partie muette ; la langue humaine fut, pour ainsi dire, entièrement articulée, formée à la fois de signes et de gestes » (3, 1, p. 178, tr. Chaix-Ruy).
Cited in De la grammatologie p.367
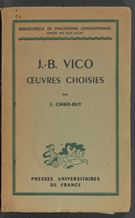
Oeuvres choisies de Vico
1946
p. 430
« Nous croyons avoir victorieusement réfuté l'erreur commune des grammairiens qui prétendent que la prose précéda les vers, et après avoir montré dans l'origine de la poésie, telle que nous l'avons découverte, l'origine des langues et celle des lettres. » (Livre II, De la sagesse poétique, chap. V, § 5, trad. Michelet, p. 430).
Cited in De la grammatologie p.367

Journal in Oeuvres complètes de Franz Kafka
p. 410
« D'une lettre : « C'est à ce feu que je me chauffe pendant ce triste hiver. » Les métaphores sont l'une des choses qui me font désespérer de l'écriture » (Schreiben). L'écriture manque d'indépendance, elle dépend de la bonne qui fait du feu, du chat qui se chauffe près du poêle, même de ce pauvre bonhomme qui se réchauffe. Tout cela répond à des fonctions autonomes ayant leurs lois propres, seule l'écriture ne puise en elle-même aucun secours, ne loge pas en elle-même, est à la fois jeu et désespoir. » (Kafka, Journal, 6 décembre 1921.)
Cited in De la grammatologie p.367

Confessions in Oeuvres complètes de J.-J. Rousseau, vol. I
p. 347
« Je suis le premier, peut-être qui ait vu sa portée » dit Rousseau de Condillac, rappelant leurs « tête-à-tête en picnic » au moment où celui-ci « travaillait à l'Essai sur l'origine des connaissances humaines » (Confessions, p. 347).
Cited in De la grammatologie p.368
Essai sur l'origine des connaissances humaines
1746
p. 177
Condillac reconnaît, plutôt que sa dette, la convergence de sa pensée avec celle de Warburton. Encore cette convergence, nous le verrons à l'instant, n'est-elle pas entière : « Cette section était presque achevée quand l'Essai sur les Hiéroglyphes, traduit de l'anglais de M. Warburton, me tomba entre les mains : ouvrage où l'esprit philosophique et l'érudition règnent également. Je vis avec plaisir que j'avais pensé, comme son auteur, que le langage a dû, dès les commencements, être fort figuré et fort métaphorique. Mes propres réflexions m'avaient aussi conduit à remarquer que l'écriture n'avait d'abord été qu'une simple peinture ; mais je n'avais point encore tenté de découvrir par quels progrès on était arrivé à l'invention des lettres, et il me paraissait difficile d'y réussir. La chose a été parfaitement exécutée par M. Warburton ; j'ai extrait de son ouvrage tout ce que j'en dis, ou à peu près. » (Ch. XIII De l'écriture, § 127. p. 177).
Cited in De la grammatologie p.369
The Divine legation of Moses
1744
p. 195
Mais à la différence de Vico, de Condillac et de Rousseau, Warburton pense que la métaphore originaire « ne vient point, comme on le suppose ordinairement, du feu d'une imagination poétique ». « La métaphore est due évidemment à la grossièreté de la conception. »
Cited in De la grammatologie p.369
The Divine legation of Moses
1744
pp. 85-86
« On peut dire que la similitude répond aux marques ou caractères de l'écriture chinoise ; et que, comme ces marques ont produit la méthode abrégée des lettres alphabétiques, de même aussi pour rendre le discours plus coulant, et plus élégant, la similitude a produit la métaphore, qui n'est autre qu'une similitude en petit. Car les hommes étant aussi habitués qu'ils le sont aux objets matériels, ont toujours eu besoin d'images sensibles, pour communiquer leurs idées abstraites. » (Essai sur les hiéroglyphes, T. I, pp. 85-86.)
Cited in De la grammatologie p.369
The Divine legation of Moses
1744
pp. 195-197
« Telle est l'origine véritable de l'expression figurée, et elle ne vient point, comme on le suppose ordinairement, du feu d'une imagination poétique. Le style des Barbares de l'Amérique, quoiqu'ils soient d'une complexion très froide et très flegmatique, le démontre encore aujourd'hui... Leur phlegme a bien pu rendre leur style concis, mais il n'a pu en retrancher les figures. Ainsi l'union de ces caractères différents montre clairement que la métaphore est due à la nécessité et non au choix... La conduite de l'homme, comme nous voyons, a toujours été, soit dans le discours et dans l'écriture, soit dans le vêtement et le logement, de changer ses besoins et ses nécessités en parade et en ornement » (pp. 195-197).
Cited in De la grammatologie p.369
Essai sur l'origine des langues
1817
« Il est donc à croire que les besoins dictèrent les premiers gestes, et que les passions arrachèrent les premières voix. En suivant avec ces distinctions la trace des faits, peut-être faudrait-il raisonner sur l'origine des langues tout autrement qu'on n'a fait jusqu'ici. Le génie des langues orientales, les plus anciennes qui nous soient connues, dément absolument la marche didactique qu'on imagine dans leur composition. Ces langues n'ont rien de méthodique et de raisonné ; elles sont vives et figurées. On nous fait du langage des premiers hommes des langues de géomètres, et nous voyons que ce furent des langues de poètes. »
Cited in De la grammatologie p.370
Essai sur l'origine des connaissances humaines
1746
Sans le critiquer directement sur ce point, il s'oppose de la sorte à Condillac. Pour celui-ci, « la parole, en succédant au langage d'action, en conserva le caractère. Cette nouvelle manière de communiquer nos pensées ne pouvait être imaginée que sur le modèle de la première. Ainsi, pour tenir la place des mouvements violents du corps, la voix s'éleva et s'abaissa par des intervalles fort sensibles » (II, I, 11, § 13).
Cited in De la grammatologie p.370