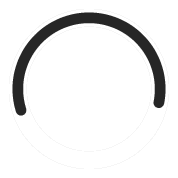Essai sur l'origine des langues
1817
Mais comment distinguer par écrit un homme qu'on nomme d'un homme qu'on appelle ? C'est là vraiment une équivoque qu'eût levée le point vocatif.
Cited in De la grammatologie p.152
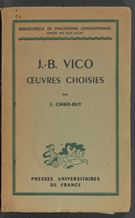
Scienza Nuova in Oeuvres choisies de Vico
p. 82
Chez Vico : B. Gagnebin et M. Raymond se sont demandé, à propos de l'Essai sur l'origine des langues, si Rousseau n'avait pas lu la Science nouvelle lorsqu'il était secrétaire de Montaigu à Venise.
Cited in De la grammatologie p.152

Philosophie der Symbolischen Formen
1953
p. 150
Cassirer n'hésite pas à affirmer que Rousseau a « repris » dans l'Essai les théories de Vico sur le langage (Philosophie der symbolischen Formen, I, I, 4).
Cited in De la grammatologie p.152
La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara
1948
Pénétration, donc, dans « le monde perdu » des Nambikwara, « petite bande d'indigènes nomades qui sont parmi les plus primitifs qu'on puisse rencontrer dans le monde » sur « un territoire grand comme la France », traversé par une picada (piste grossière dont le « tracé » est presque « indiscernable de la brousse »
Cited in De la grammatologie p.153
La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara
1948
« Fil d'une ligne téléphonique abandonnée, "devenu inutile aussitôt que posé" et qui "se détend sur des poteaux qu'on ne remplace pas quand ils tombent en pourriture, victimes des termites ou des Indiens qui prennent le bourdonnement caractéristique d'une ligne télégraphique pour celui d'une ruche d'abeilles sauvages en travail". »
Cited in De la grammatologie p.153
La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara
1948
Les Nambikwara dont le harcèlement et la cruauté – présumée ou non – sont très redoutés par le personnel de la ligne « ramènent l'observateur à ce qu'il prendrait volontiers – mais à tort – pour une enfance de l'humanité. »
Cited in De la grammatologie p.154
La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara
1948
« Tous étaient parents entre eux, les Nambikwara épousant de préférence une nièce de l'espèce dite croisée par les ethnologues ; fille de la sœur du père ou du frère de la mère. »
Cited in De la grammatologie p.154
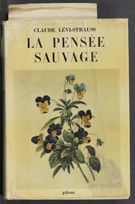
La pensée sauvage
1962
p. 240
« Nous sommes donc en présence de deux types extrêmes de noms propres, entre lesquels existent toute une série d'intermédiaires. Dans un cas, le nom est une marque d'identification, qui confirme, par application d'une règle, l'appartenance de l'individu qu'on nomme à une classe préordonnée (un groupe social dans un système de groupes, un statut natal dans un système de statuts) ; dans l'autre cas, le nom est une libre création de l'individu qui nomme et qui exprime, au moyen de celui qu'il nomme, un état transitoire de sa propre subjectivité. Mais peut-on dire que, dans l'un ou l'autre cas, on nomme véritablement ? Le choix, semble-t-il, n'est qu'entre identifier l'autre en l'assignant à une classe, ou, sous couvert de lui donner un nom, de s'identifier soi-même à travers lui. On ne nomme donc jamais : on classe l'autre, si le nom qu'on lui donne est fonction des caractères qu'il a, ou on se classe soi-même si, se croyant dispensé de suivre une règle, on nomme l'autre "librement" : c'est-à-dire en fonction des caractères qu'on a. Et le plus souvent, on fait les deux choses à la fois ». (p. 240).
Cited in De la grammatologie p.155
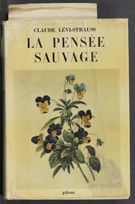
La pensée sauvage
1962
pp. 287-323
Cf. aussi « L'individu comme espèce » et « Le temps retrouvé » (ch. VII et VIII)
Cited in De la grammatologie p.155
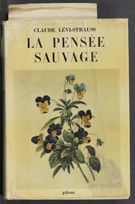
La pensée sauvage
1962
pp. 285-286
« Dans chaque système, par conséquent, les noms propres représentent des quanta de signification au-dessous desquels on ne fait plus rien que montrer. Nous atteignons ainsi à la racine l'erreur parallèle commise par Peirce et par Russell, le premier en définissant le nom propre comme un "index", le second en croyant découvrir le modèle logique du nom propre dans le prénom démonstratif. C'est admettre, en effet, que l'acte de nommer se situe dans un continu où s'accomplirait insensiblement le passage de l'acte de signifier à celui de montrer. Au contraire, nous espérons avoir établi que ce passage est discontinu, bien que chaque culture en fixe autrement les seuils. Les sciences naturelles situent leur seuil au niveau de l'espèce, de la variété, ou de la sous-variété, selon les cas. Ce seront donc des termes de généralité différente qu'elles percevront chaque fois comme noms propres » (pp. 285-286).
Cited in De la grammatologie p.155
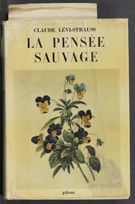
La pensée sauvage
1962
p. 288
Peut-être faudrait-il dire de l'indication « propre » ce que Lévi-Strauss dit encore ailleurs des noms propres : « Vers le bas, le système ne connaît pas non plus de limite externe, puisqu'il réussit à traiter la diversité qualitative des espèces naturelles comme la matière symbolique d'un ordre, et que sa marche vers le concret, le spécial, et l'individuel, n'est même pas arrêtée par l'obstacle des appellations personnelles : il n'est pas jusqu'aux noms propres qui ne puissent servir de termes à une classification » (p. 288)
Cited in De la grammatologie p.155
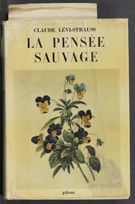
La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara
1948
« L'emploi du nom propre est chez eux interdit », note Lévi-Strauss.
Cited in De la grammatologie p.155

Tristes Tropiques
1955
p. 262
« On se doute que les Nambikwara ne savent pas écrire. »
Cited in De la grammatologie p.157

Rêveries du promeneur solitaire in Oeuvres complètes de J.-J. Rousseau, vol. I
pp. 1092-1093
« Mais bientôt ennuyé de vider ma bourse pour faire écraser les gens, je laissai là la bonne compagnie et je fus me promener seul dans la foire. La variété des objets m'amusa longtemps. J'aperçus entre autre cinq ou six Savoyards autour d'une petite fille qui avait encore sur son inventaire une douzaine de chétives pommes dont elle aurait bien voulu se débarrasser. Les Savoyards de leur côté auraient bien voulu l'en débarrasser mais ils n'avaient que deux ou trois liards à eux tous et ce n'était pas de quoi faire une grande brèche aux pommes. Cet inventaire était pour eux le jardin des Hespérides, et la petite fille était le dragon qui le gardait. Cette comédie m'amusa longtemps ; j'en fis enfin le dénouement en payant les pommes à la petite fille et en les lui faisant distribuer aux petits garçons. J'eus alors un des plus doux spectacles qui puissent flatter un cœur d'homme, celui de voir la joie unie avec l'innocence de l'âge se répandre autour de moi. Car les spectateurs mêmes en la voyant la partagèrent, et moi qui partageais à si bon marché cette joie, j'avais de plus celle de sentir qu'elle était mon ouvrage. »
Cited in De la grammatologie p.158

Tristes Tropiques
1955
p. 244
« Si faciles que fussent les Nambikwara – indifférents à la présence de l'ethnographe, à son carnet de notes et à son appareil photographique – le travail se trouvait compliqué pour des raisons linguistiques. D'abord l'emploi des noms propres est chez eux interdit ; pour identifier les personnes, il fallait suivre l'usage des gens de la ligne, c'est-à-dire convenir avec les indigènes des noms d'emprunt par lesquels on les désignerait. Soit des noms portugais, comme Julio, José-Maria, Luiza ; soit des sobriquets : Lebre (lièvre), Assucar (sucre). J'en ai même connu un que Rondon, ou l'un de ses compagnons, avait baptisé Cavaignac à cause de sa barbiche, rare chez les Indiens qui sont généralement glabres. Un jour que je jouais avec un groupe d’enfants, une des fillettes fut frappée par une camarade, elle vint se réfugier auprès de moi, et se mit, en grand mystère, à me murmurer quelque chose à l'oreille que je ne compris pas, et que je fus obligé de lui faire répéter à plusieurs reprises, si bien que l'adversaire découvrit le manège, et, manifestement furieuse, arriva à son tour livrer ce qui parut être un secret solennel ; après quelques hésitations et questions, l’interprétation de l'incident ne laissa pas de doute. La première fillette était venue, par vengeance, me donner le nom de son ennemie, et quand celle-ci s'en aperçut, elle communiqua le nom de l'autre, en guise de représailles. À partir de ce moment, il fut très facile, bien que peu scrupuleux, d'exciter les enfants les uns contre les autres, et d'obtenir tous leurs noms. Après quoi, une petite complicité ainsi créée, ils me donnèrent sans trop de difficulté les noms des adultes. Lorsque ceux-ci comprirent nos conciliabules, les enfants furent réprimandés, et la source de mes informations tarie. »
Cited in De la grammatologie p.158