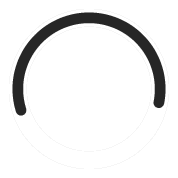Le déchiffrement des écritures
1959
Les techniques de déchiffrement, on le sait, n'ont cessé de progresser à un rythme accéléré.
Cited in De la grammatologie p.116
The Divine legation of Moses
1744
Mais Fréret n'est pas pour autant délivré du préjugé hiéroglyphiste : celui que Warburton détruit en critiquant violemment le Père Kircher. Le propos apologétique qui anime cette critique n'en exclut pas l'efficacité.
Cited in De la grammatologie p.116
Histoire de l'écriture dans l'antiquité
1892
p. XX
« Le plus souvent les faits ne se conforment pas à des distinctions qui... ne sont justes qu'en théorie ».
Cited in De la grammatologie p.117
Le débat sur les écritures et l'hiéroglyphe aux XVIIe et XVIIIe siècles
1965
M. V.-David critique cet intrumentalisme dans les travaux déjà cités. L'instrumentalisme, dont on ne saurait exagérer la dépendance métaphysique, inspire aussi souvent la définition linguistique de l'essence du langage, assimilée à une fonction et, ce qui est plus grave, à une fonction extérieure à son contenu ou à son agent. C'est ce qu'implique toujours le concept d'outil.
Cited in De la grammatologie p.117
La grande invention de l'écriture
1958
p. 2
Or cet instrumentalisme est partout impliqué. Nulle part il n'est aussi systématiquement formulé, avec toutes ses conséquences, que par M. Cohen : Le langage étant un « instrument », l'écriture est « la rallonge à un instrument ».
Cited in De la grammatologie p.117

Éléments de linguistique générale
1960
pp. 12-14
Ainsi, A. Martinet prend à son compte et développe longuement la définition du langage comme « instrument », « outil », etc., alors que la nature « métaphorique » de cette définition, reconnue par l'auteur, aurait dû la rendre problématique et renouveler la question sur le sens de l'instrumentalité, sur le sens du fonctionnement et sur le fonctionnement du sens. (Cf. Eléments de linguistique générale, pp. 12-14, 25).
Cited in De la grammatologie p.118

Éléments de linguistique générale
1960
p. 25
Ainsi, A. Martinet prend à son compte et développe longuement la définition du langage comme « instrument », « outil », etc., alors que la nature « métaphorique » de cette définition, reconnue par l'auteur, aurait dû la rendre problématique et renouveler la question sur le sens de l'instrumentalité, sur le sens du fonctionnement et sur le fonctionnement du sens. (Cf. Eléments de linguistique générale, pp. 12-14, 25).
Cited in De la grammatologie p.118
La grande invention de l'écriture
1958
p. 49
« Le problème est d'ordre linguistique, nous ne l'aborderons pas ici ».
Cited in De la grammatologie p.118
La grande invention de l'écriture
1958
p. 6
l'opposition entre l'analyse et la synthèse, l'abstrait et le concret, qui joue un rôle décisif dans les classifications proposées par J. Février et M. Cohen et dans le débat qui les oppose ; un concept du concept sur lequel la réflexion philosophique la plus classique a laissé peu de marques ; une référence à la conscience et à l'inconscience qui appellerait de toute nécessité un usage plus vigilant de ces notions et quelque considération pour les recherches qui en font leur thème ;
Cited in De la grammatologie p.118

L'Ecriture et la psychologie des peuples: actes de colloque
1963
p. 349
« C'est [la mathématique] une langue spéciale qui n'a plus aucun rapport avec le langage, c'est une espèce de langue universelle, c'est-à-dire que nous constatons par les mathématiques que le langage — je me venge des linguistes — est absolument incapable de rendre compte de certaines formes de la pensée moderne. Et à ce moment-là, l'écriture, qui a été tellement méconnue, prend la place du langage, après avoir été sa servante » (EP. p. 349).
Cited in De la grammatologie p.119
Le geste et la parole
1965
p. II, 32
A. Leroi-Gourhan le montre bien : refuser le nom d'homme et le pouvoir d'écriture au-delà de sa propre communauté, c'est un seul et même geste. En vérité, les peuples dits « sans écriture » ne manquent jamais que d'un certain type d'écriture. Refuser à telle ou telle technique de consignation le nom d'écriture, tel est l' « ethnocentrisme, qui définit le mieux la vision préscientifique de l'homme » et fait en même temps que « dans de nombreux groupes humains, le seul mot par lequel les membres désignent leur groupe ethnique est le mot « homme » » (GP. 11, p. 32 et passim).
Cited in De la grammatologie p.120
Le geste et la parole
1965
p. 12
Mais il ne suffit pas de dénoncer l'ethnocentrisme et de définir l'unité anthropologique par la disposition de l'écriture. A. Leroi-Gourhan ne décrit plus ainsi l'unité de l'homme et de l'aventure humaine par la simple possibilité de la graphie en général : plutôt comme une étape ou une articulation dans l'histoire de la vie — de ce que nous appelons ici la différance —comme histoire du gramme. Au lieu de recourir aux concepts qui servent habituellement à distinguer l'homme des autres vivants (instinct et intelligence, absence ou présence de la parole, de la société, de l'économie, etc., etc.), on fait ici appel à la notion de programme. Il faut l'entendre, certes, au sens de la cybernétique, mais celle-ci n'est elle-même intelligible qu'à partir d'une histoire des possibilités de la trace comme unité d'un double mouvement de protention et de rétention. Ce mouvement déborde largement les possibilités de la « conscience intentionnelle ». Celle-ci est une émergence qui fait apparaître le gramme comme tel (c'est-à-dire selon une nouvelle structure de non-présence) et rend sans doute possible le surgissement des systèmes d'écriture au sens étroit. Depuis l' « inscription génétique » et les « courtes chaînes » programmatiques réglant le comportement de l'amibe ou de l'annélide jusqu'au passage au-delà de l'écriture alphabétique aux ordres du logos et d'un certain homo sapiens, la possibilité du gramme structure le mouvement de son histoire selon des niveaux, des types, des rythmes rigoureusement originaux.
Cited in De la grammatologie p.120
Le geste et la parole
1965
p. 23
Mais il ne suffit pas de dénoncer l'ethnocentrisme et de définir l'unité anthropologique par la disposition de l'écriture. A. Leroi-Gourhan ne décrit plus ainsi l'unité de l'homme et de l'aventure humaine par la simple possibilité de la graphie en général : plutôt comme une étape ou une articulation dans l'histoire de la vie — de ce que nous appelons ici la différance —comme histoire du gramme. Au lieu de recourir aux concepts qui servent habituellement à distinguer l'homme des autres vivants (instinct et intelligence, absence ou présence de la parole, de la société, de l'économie, etc., etc.), on fait ici appel à la notion de programme. Il faut l'entendre, certes, au sens de la cybernétique, mais celle-ci n'est elle-même intelligible qu'à partir d'une histoire des possibilités de la trace comme unité d'un double mouvement de protention et de rétention. Ce mouvement déborde largement les possibilités de la « conscience intentionnelle ». Celle-ci est une émergence qui fait apparaître le gramme comme tel (c'est-à-dire selon une nouvelle structure de non-présence) et rend sans doute possible le surgissement des systèmes d'écriture au sens étroit. Depuis l' « inscription génétique » et les « courtes chaînes » programmatiques réglant le comportement de l'amibe ou de l'annélide jusqu'au passage au-delà de l'écriture alphabétique aux ordres du logos et d'un certain homo sapiens, la possibilité du gramme structure le mouvement de son histoire selon des niveaux, des types, des rythmes rigoureusement originaux.
Cited in De la grammatologie p.120
Le geste et la parole
1965
p. 262
Mais il ne suffit pas de dénoncer l'ethnocentrisme et de définir l'unité anthropologique par la disposition de l'écriture. A. Leroi-Gourhan ne décrit plus ainsi l'unité de l'homme et de l'aventure humaine par la simple possibilité de la graphie en général : plutôt comme une étape ou une articulation dans l'histoire de la vie — de ce que nous appelons ici la différance —comme histoire du gramme. Au lieu de recourir aux concepts qui servent habituellement à distinguer l'homme des autres vivants (instinct et intelligence, absence ou présence de la parole, de la société, de l'économie, etc., etc.), on fait ici appel à la notion de programme. Il faut l'entendre, certes, au sens de la cybernétique, mais celle-ci n'est elle-même intelligible qu'à partir d'une histoire des possibilités de la trace comme unité d'un double mouvement de protention et de rétention. Ce mouvement déborde largement les possibilités de la « conscience intentionnelle ». Celle-ci est une émergence qui fait apparaître le gramme comme tel (c'est-à-dire selon une nouvelle structure de non-présence) et rend sans doute possible le surgissement des systèmes d'écriture au sens étroit. Depuis l' « inscription génétique » et les « courtes chaînes » programmatiques réglant le comportement de l'amibe ou de l'annélide jusqu'au passage au-delà de l'écriture alphabétique aux ordres du logos et d'un certain homo sapiens, la possibilité du gramme structure le mouvement de son histoire selon des niveaux, des types, des rythmes rigoureusement originaux.
Cited in De la grammatologie p.120
Le geste et la parole
1965
p. I, 119
A. Leroi-Gourhan décrit la lente transformation de la motricité manuelle qui délivre le système audio-phonique pour la parole, le regard et la main pour l'écriture.
Cited in De la grammatologie p.121
Le geste et la parole
1965
p. 161
On accède alors à cette représentation de l'anthropos : équilibre précaire lié à l'écriture manuelle-visuelle.
Cited in De la grammatologie p.121