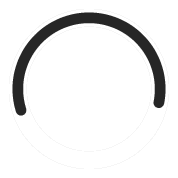Prononciation in Oeuvres complètes de J.-J. Rousseau, vol. II
p. 1249
En apparence, Rousseau est plus prudent dans le fragment sur la Prononciation : « L'analyse de la pensée se fait par la parole, et l'analyse de la parole par l'écriture ; la parole représente la pensée par des signes conventionnels, et l'écriture représente de même la parole ; ainsi l'art d'écrire n'est qu'une représentation médiate de la pensée, *au moins quant aux langues vocales, les seules qui soient en usage parmi nous » (p. 1 249). (Nous soulignons)
Cited in De la grammatologie p.56

Cours de linguistique générale
1960
p. 101
p. 101. Au-delà des scruples formulés par Saussure lui-même, tout un système de critiques intra-linguistiques peut être opposé à la thèse de l'« arbitraire du signe ». Cf. Jakobson, À la recherche de l'essence du langage, Diogène 51, et Martinet, La linguistique synchronique, p. 34. Mais ces critiques n'entament pas – et n'y prétendent d'ailleurs pas – l'intention profonde de Saussure visant la discontinuité et l'immotivation propres à la structure sinon à l'origine du signe.
Cited in De la grammatologie p.62
Principes de phonologie
p. 2
« La face signifiante de la langue ne peut consister qu'en des règles d'après lesquelles est ordonnée la face phonique de l'acte de parole. » Troubetzkoy, Principes de phonologie, tr. fr., p. 2.
Cited in De la grammatologie p.62
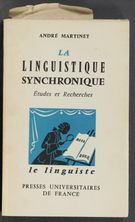
La linguistique synchronique: Études et Recherches
1965
p. 34
p. 101. Au-delà des scruples formulés par Saussure lui-même, tout un système de critiques intra-linguistiques peut être opposé à la thèse de l'« arbitraire du signe ». Cf. Jakobson, À la recherche de l'essence du langage, Diogène 51, et Martinet, La linguistique synchronique, p. 34. Mais ces critiques n'entament pas – et n'y prétendent d'ailleurs pas – l'intention profonde de Saussure visant la discontinuité et l'immotivation propres à la structure sinon à l'origine du signe.
Cited in De la grammatologie p.62
À la recherche de l'essence du langage
p. 51
p. 101. Au-delà des scruples formulés par Saussure lui-même, tout un système de critiques intra-linguistiques peut être opposé à la thèse de l'« arbitraire du signe ». Cf. Jakobson, À la recherche de l'essence du langage, Diogène 51, et Martinet, La linguistique synchronique, p. 34. Mais ces critiques n'entament pas – et n'y prétendent d'ailleurs pas – l'intention profonde de Saussure visant la discontinuité et l'immotivation propres à la structure sinon à l'origine du signe.
Cited in De la grammatologie p.62
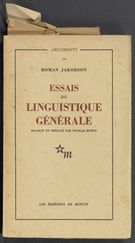
Essais de linguistique générale
1963
p. 103
C'est dans Phonologie et phonétique de Jakobson et Halle (première partie de Fundamentals of language, recueillie et traduite in Essais de linguistique générale, p. 103) que la ligne phonologiste du projet saussurien se trouve, semble-t-il, le plus systématiquement et le plus rigoureusement défendue, notamment contre le point de vue « algébrique » de Hjelmslev.
Cited in De la grammatologie p.62
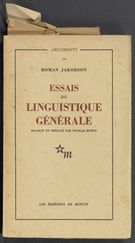
Essais de linguistique générale
1963
p. 103
Saussure n'a donc jamais pu penser que l'écriture fût vraiment une « image », une « figuration », une « représentation » de la langue parlée, un symbole. Si l'on considère qu'il eut pourtant besoin de ces notions pour décider de l'extériorité de l'écriture, on doit conclure que tout une strate de son discours, l'intention du chapitre VI (Représentation de la langue par l'écriture), n'était rien moins que scientifique.
Cited in De la grammatologie p.64

Cours de linguistique générale
1960
p. 33
« Nous la nommerons [grammatologie]… Puisqu'elle n'existe pas encore, on ne peut dire ce qu'elle sera ; mais elle a droit à l'existence, sa place est déterminée d'avance. La linguistique n'est qu'une partie de cette science générale, les lois que découvrira la [grammatologie] seront applicables à la linguistique » (p. 33).
Cited in De la grammatologie p.71
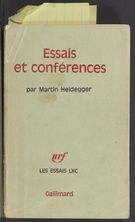
La chose in Essais et conférences
pp. 214-218
C'est bien évidemment à Nietzsche que nous renvoient encore ces thèmes présents dans la pensée de Heidegger (cf. La chose, 1950, tr. fr. in Essais et conférences, p. 214 sq. Le principe de raison, 1955-1956, tr. fr. p. 240 sq.), de Fink (Le jeu comme symbole du monde, 1960) et, en France, de K. Axelos (Vers la pensée planétaire, 1964 et Einführung ein ein künftiges Denken, 1966).
Cited in De la grammatologie p.71
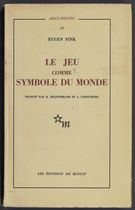
Le jeu comme symbole du monde
1960
C'est bien évidemment à Nietzsche que nous renvoient encore ces thèmes présents dans la pensée de Heidegger (cf. La chose, 1950, tr. fr. in Essais et conférences, p. 214 sq. Le principe de raison, 1955-1956, tr. fr. p. 240 sq.), de Fink (Le jeu comme symbole du monde, 1960) et, en France, de K. Axelos (Vers la pensée planétaire, 1964 et Einführung ein ein künftiges Denken, 1966).
Cited in De la grammatologie p.71
Einführung in ein künftiges Denken
1966
C'est bien évidemment à Nietzsche que nous renvoient encore ces thèmes présents dans la pensée de Heidegger (cf. La chose, 1950, tr. fr. in Essais et conférences, p. 214 sq. Le principe de raison, 1955-1956, tr. fr. p. 240 sq.), de Fink (Le jeu comme symbole du monde, 1960) et, en France, de K. Axelos (Vers la pensée planétaire, 1964 et Einführung ein ein künftiges Denken, 1966).
Cited in De la grammatologie p.71
Le Principe de raison
1962
p. 240
C'est bien évidemment à Nietzsche que nous renvoient encore ces thèmes présents dans la pensée de Heidegger (cf. La chose, 1950, tr. fr. in Essais et conférences, p. 214 sq. Le principe de raison, 1955-1956, tr. fr. p. 240 sq.), de Fink (Le jeu comme symbole du monde, 1960) et, en France, de K. Axelos (Vers la pensée planétaire, 1964 et Einführung ein ein künftiges Denken, 1966).
Cited in De la grammatologie p.71
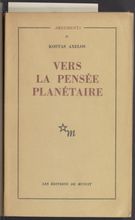
Vers la pensée planétaire
1964
C'est bien évidemment à Nietzsche que nous renvoient encore ces thèmes présents dans la pensée de Heidegger (cf. La chose, 1950, tr. fr. in Essais et conférences, p. 214 sq. Le principe de raison, 1955-1956, tr. fr. p. 240 sq.), de Fink (Le jeu comme symbole du monde, 1960) et, en France, de K. Axelos (Vers la pensée planétaire, 1964 et Einführung ein ein künftiges Denken, 1966).
Cited in De la grammatologie p.71

Cours de linguistique générale
1960
p. 164
« Il est impossible que le son, élément matériel, appartienne lui-même à la langue. Il n'est pour elle qu'une chose secondaire, une matière qu'elle met en œuvre. Toutes les valeurs conventionnelles présentent ce caractère de ne pas se confondre avec l'élément tangible qui leur sert de support… » « Dans son essence, il [le signifiant linguistique] n'est aucunement phonique, il est incorporel, constitué, non par sa substance matérielle, mais uniquement par les différences qui séparent son image acoustique de toutes les autres » (p. 164).
Cited in De la grammatologie p.74

Cours de linguistique générale
1960
p. 163
« Arbitraire et différentiel sont deux qualités corrélatives » (p. 163).
Cited in De la grammatologie p.74
Au sujet des fondements de la théorie linguistique de Louis Hjelmslev
1946
p. 40
Cette fidélité littérale s'exprime : 1) dans l'exposé critique de la tentative de Hjelmslev (Au sujet des fondements de la théorie linguistique de L. Hjelmslev, in Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, t. 42, p. 40) : « Hjelmslev est parfaitement logique avec lui-même lorsqu'il déclare qu'un texte écrit a pour la linguistique exactement la même valeur qu'un texte parlé, puisque le choix de la substance n'importe pas. Il se refuse même à admettre que la substance parlée soit primitive et la substance écrite dérivée. Il semble qu'il suffirait de lui faire remarquer qu'à quelques exceptions pathologiques, près, tous les hommes parlent, mais que peu savent écrire, ou encore que les enfants savent parler longtemps avant d'apprendre l'écriture. Nous n’insisterons donc pas. » [Nous soulignons.]
Cited in De la grammatologie p.77